L’Évangile comme récit de paix
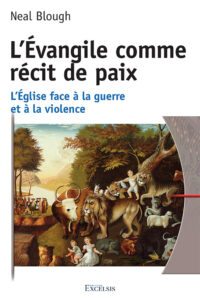 L’Église face à la guerre et à la violence
L’Église face à la guerre et à la violence
Auteur : Neal Blough
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Vie d’Eglise, nouveauté
Diffusion Excelsis
Broché avril 2025
Pages (ou cartes) : 288
Poids : 355 grammes
Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755005905
Table des matières – Extrait 1
Dis-moi qui tu es…
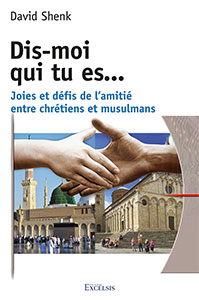 Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans
Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans
Titre original : Christian. Muslim. Friend. Twelve Paths to Real Relationship
Auteur : David Shenk
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes
Catégorie 2 : Nouveautés
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 232
Poids : 290 grammes
Dépôt légal : Octobre 2023
Dimensions : 14 x 21 centimètres
EAN / Référence : 9782755005165
Table des matières – Extrait 1 – Extrait 2
Alphabet de spiritualité anabaptiste
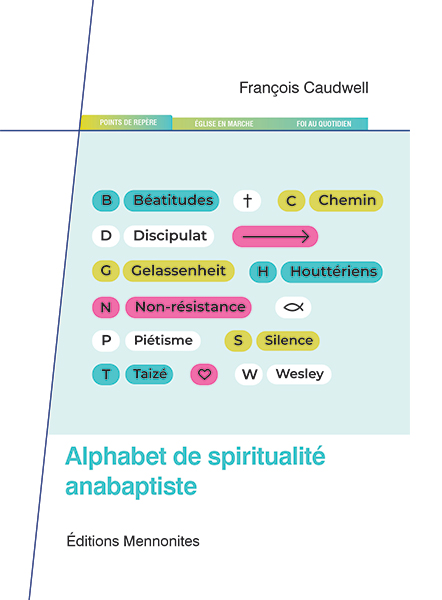 Par François Caudwell
Par François Caudwell
En suivant l’alphabet de A à Z en 40 articles courts, ce livre présente les convictions et la spiritualité des anabaptistes.
On y trouve par ex. B comme Béatitudes, D comme discipulat, G comme grâce, I comme imitation, M comme martyr, N comme non-résistance, P comme paix ; mais aussi des thèmes moins connus : G comme Gelassenheit, H comme houttériens ou plus surprenants M comme moine, T comme Taizé, W comme Wesley…
A chaque fois, les mots choisis en titre prennent vie et deviennent programme. Chaque notion ou thème est présenté à l’aide de citations de la Bible, mais aussi d’auteurs chrétiens à travers l’Histoire, avec une large place faite aux anabaptistes du 16e siècle bien sûr. Au fil des pages, l’accent typiquement anabaptiste de la suivance du Christ sert de fil rouge.
Une des particularités de l’ouvrage est l’approche « en dialogue », au sens où les citations de provenances ecclésiales ou spirituelles diverses convergent de belle manière, comme un exemple de bienveillance mutuelle chère à l’auteur.
Le lecteur peut picorer ici ou là au gré des articles sans nécessité de tout lire à la suite ; des questions de réflexion et de discussion sont proposés à la fin de chaque article. « Le livre parcourt les grands thèmes de la foi pour mettre en valeur la singularité de l’approche anabaptiste. Un bel outil pour ceux qui veulent approfondir leurs racines spirituelles. » (Antoine Nouis)
Histoire, identité et dialogue
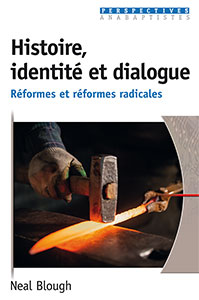 Réformes et réformes radicales
Réformes et réformes radicales
Auteur : Neal Blough
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 352
Poids : 440 grammes
Dépôt légal : Avril 2022
Dimensions : 14 x 21 x 1,9 centimètres
EAN / Référence : 9782755004793
Que celui qui est sans péché
 Entre minimisation et surenchère du péché
Entre minimisation et surenchère du péché
Sous la direction de : Michel Sommer – Denis Kennel
Auteurs : Denis Kennel – Michel Sommer – Lukas Amstutz – Janie Blough – Frédéric de Coninck – Hanspeter Jecker – Daniel Plessing – Marcus Weiand
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 168
Poids : 215 grammes
Dépôt légal : Mars 2019
Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres
EAN / Référence : 9782755003529
De l’Écriture à la communauté de disciples
 Sous la direction de : Neal Blough
Sous la direction de : Neal Blough
Auteurs : Frédéric de Coninck – Neal Blough – Michel Sommer – Paul Solomiac – Linda Oyer – Antonio González – Jean-Claude Girondin
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 328
Poids : 390 grammes
Dépôt légal : Mars 2016
Dimensions : 14 x 21 x 1,7 centimètres
EAN / Référence : 9782755002836
Dis-moi ce que tu crois…
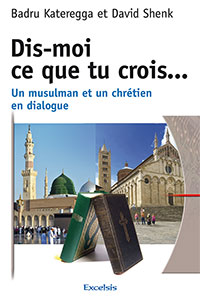 Un musulman et un chrétien en dialogue
Un musulman et un chrétien en dialogue
Titre original : A Muslim and a Christian in Dialogue
Auteurs : David Shenk – Badru Kateregga
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 312
Poids : 380 grammes
Dépôt légal : Juin 2015
Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755002386
De la paix du Christ à la « politique » de l’Église
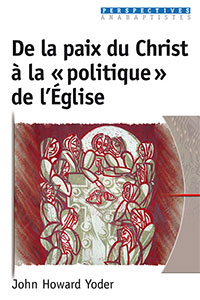 Titre original : He Came Preaching Peace
Titre original : He Came Preaching Peace
Auteur : John H. Yoder
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Vie d’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 272
Poids : 330 grammes
Dépôt légal : Novembre 2014
Dimensions : 14 x 21 x 1,4 centimètres
EAN / Référence : 9782755002195
Quand le pardon transcende la tragédie
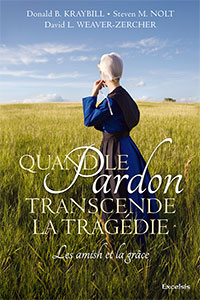 Les amish et la grâce
Les amish et la grâce
Titre original : Amish Grace
Auteurs : David Weaver-Zercher – Steven Nolt – Donald Kraybill
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Biographies / Témoignages
Déstockage
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 296
Poids : 370 grammes
Dépôt légal : Juin 2014
Dimensions : 14 x 21 x 1,5 centimètres
EAN / Référence : 9782755002119
Radicalement chrétien !
 Éléments essentiels de la démarche anabaptiste
Éléments essentiels de la démarche anabaptiste
Titre original : The Naked Anabaptist, The Bare Essentials of a Radical Faith
Auteur : Stuart Murray
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 200
Poids : 290 grammes
Dépôt légal : Septembre 2013
Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755001952
Catéchèse, baptême et mission
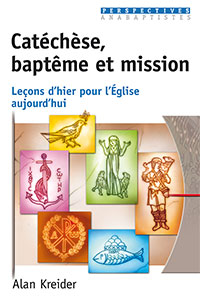 Auteur : Alan Kreider
Auteur : Alan Kreider
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Vie d’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 80
Poids : 120 grammes
Dépôt légal : Juin 2013
Dimensions : 14 x 20,9 x 0,5 centimètres
EAN / Référence : 9782755001839
Fascinant Saint-Esprit
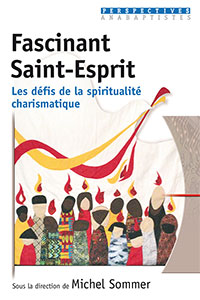 Les défis de la spiritualité charismatique
Les défis de la spiritualité charismatique
Sous la direction de : Michel Sommer
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Théologie » Doctrine du Saint-Esprit
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 160
Poids : 230 grammes
Dépôt légal : Octobre 2012
Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres
EAN / Référence : 9782755000627
Rythmes anabaptistes en Afrique
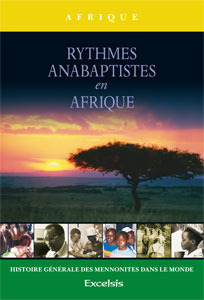 Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique
Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique
Titre original : Anabaptist Songs in African Hearts. A Global Mennonite History Series : Africa
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 312
Poids : 380 grammes
Dépôt légal : Mai 2012
Dimensions : 15 x 22 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755001617
Foi et tradition à l’épreuve
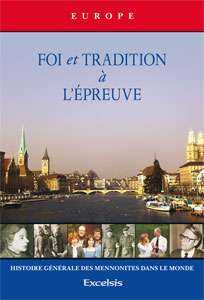 Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe
Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe
Titre original : Testing Faith and Tradition. A Global Mennonite History Series : Europe
Auteurs : Alle Hoekema – Neal Blough – Hanspeter Jecker
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 368
Poids : 440 grammes
Dépôt légal : Mai 2012
Dimensions : 15 x 22 x 1,9 centimètres
EAN / Référence : 9782755001624
Rédemption et salut
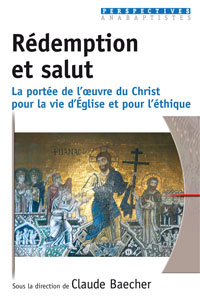 La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique
La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique
Sous la direction de : Claude Baecher
Auteurs : Pascal Keller – Frédéric de Coninck – Neal Blough – Claude Baecher – Linda Oyer – Rachel Reesor–Taylor
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Éthique
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 224
Poids : 290 grammes
Dépôt légal : Novembre 2011
Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755001402
Découvrir le réformateur Menno Simons
 Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons
Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons
Auteurs : Menno Simons – François Caudwell – Peter Riedemann
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 312
Poids : 390 grammes
Dépôt légal : Juin 2011
Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755001334
Table des matières – Extrait 1
Histoire des amish
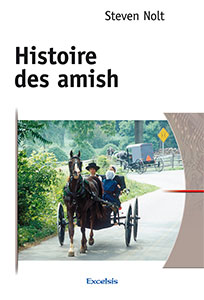 Titre original : A History of the Amish
Titre original : A History of the Amish
Auteur : Steven Nolt
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Biographies / Témoignages
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 352
Poids : 430 grammes
Dépôt légal : Novembre 2010
Dimensions : 15 x 22 x 1,7 centimètres
EAN / Référence : 9782755001181
Doctrine et vie des anabaptistes houttériens
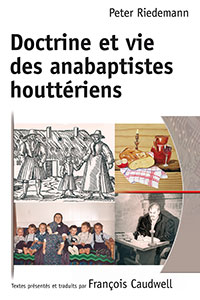 Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi
Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi
Auteurs : Peter Riedemann – François Caudwell
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 296
Poids : 335 grammes
Dépôt légal : Novembre 2007
Dimensions : 14 x 21 x 2,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755000573
La sagesse de la croix
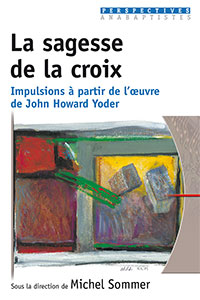 Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder
Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder
Sous la direction de : Michel Sommer
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 184
Poids : 232 grammes
Dépôt légal : Mai 2007
Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755000528
Les Amish
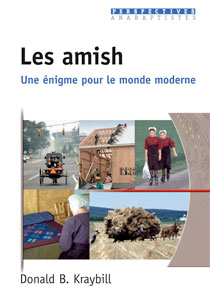 Une énigme pour le monde moderne
Une énigme pour le monde moderne
Titre original : The Riddle of Amish Culture
Auteur : Donald Kraybill
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Biographies / Témoignages
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 448
Poids : 540 grammes
Dépôt légal : Septembre 2004
Dimensions : 15 x 22 x 2,2 centimètres
EAN / Référence : 9782914144896
Miroir des martyrs
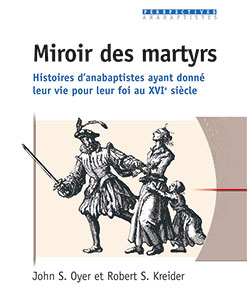 Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle
Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle
Titre original : Mirror of the Martyrs
Auteurs : Robert S. Kreider – John S. Oyer
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 96
Poids : 330 grammes
Dépôt légal : Mars 2003
Dimensions : 21,1 x 25,5 x 0,6 centimètres
EAN / Référence : 9782914144605
Michaël Sattler
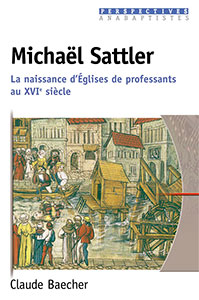 La naissance d’Églises de professants au 16e siècle
La naissance d’Églises de professants au 16e siècle
Auteur : Claude Baecher
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 144
Poids : 210 grammes
Dépôt légal : Octobre 2002
Dimensions : 14 x 21 x 0,9 centimètres
EAN / Référence : 9782914144445
Table des matières
Eschatologie et vie quotidienne
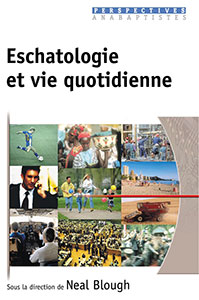 Sous la direction de : Neal Blough
Sous la direction de : Neal Blough
Auteurs : John H. Yoder – Linda Oyer – Bernard Huck – Frédéric de Coninck – Claude Baecher – Neal Blough
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Théologie » Doctrine des temps de la fin
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 160
Poids : 190 grammes
Dépôt légal : Novembre 2001
Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres
EAN / Référence : 9782914144285
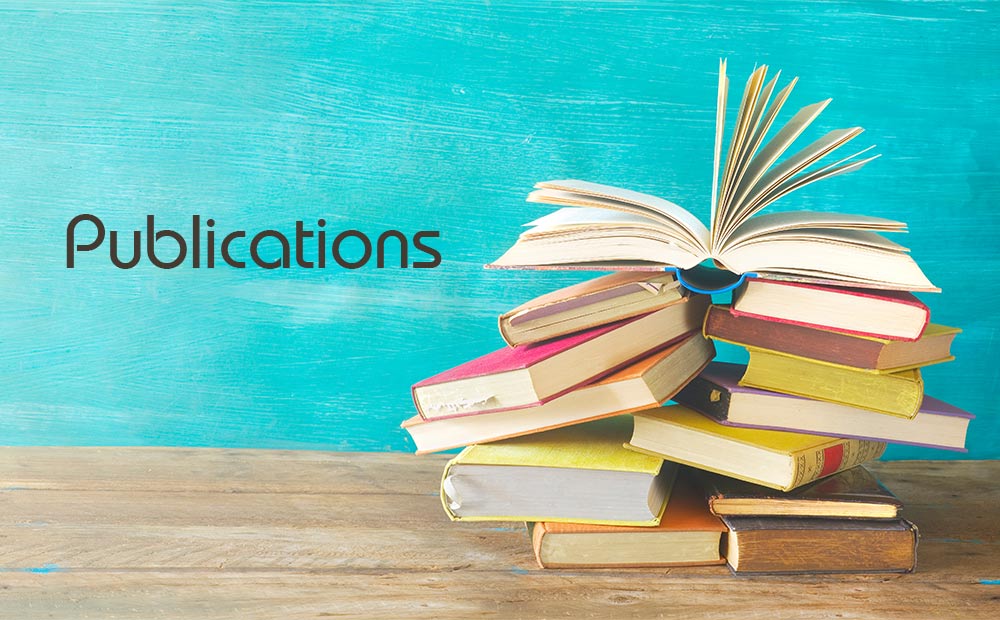
L’Évangile comme récit de paix
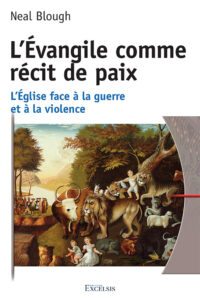 L’Église face à la guerre et à la violence
L’Église face à la guerre et à la violence
Auteur : Neal Blough
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Vie d’Eglise, nouveauté
Diffusion Excelsis
Broché avril 2025
Pages (ou cartes) : 288
Poids : 355 grammes
Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755005905
Table des matières – Extrait 1
Dis-moi qui tu es…
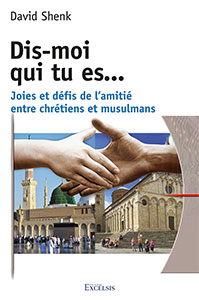 Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans
Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans
Titre original : Christian. Muslim. Friend. Twelve Paths to Real Relationship
Auteur : David Shenk
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes
Catégorie 2 : Nouveautés
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 232
Poids : 290 grammes
Dépôt légal : Octobre 2023
Dimensions : 14 x 21 centimètres
EAN / Référence : 9782755005165
Table des matières – Extrait 1 – Extrait 2
Alphabet de spiritualité anabaptiste
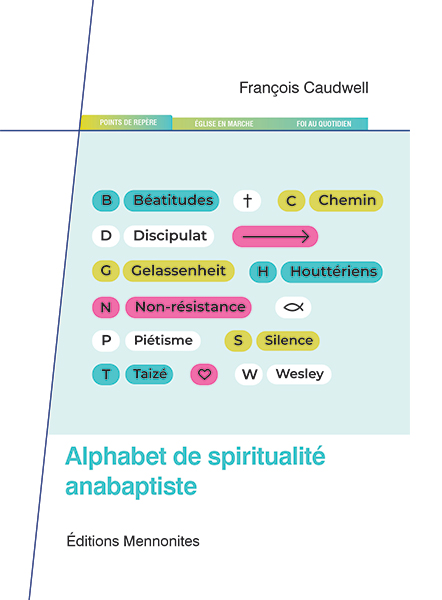 Par François Caudwell
Par François Caudwell
En suivant l’alphabet de A à Z en 40 articles courts, ce livre présente les convictions et la spiritualité des anabaptistes.
On y trouve par ex. B comme Béatitudes, D comme discipulat, G comme grâce, I comme imitation, M comme martyr, N comme non-résistance, P comme paix ; mais aussi des thèmes moins connus : G comme Gelassenheit, H comme houttériens ou plus surprenants M comme moine, T comme Taizé, W comme Wesley…
A chaque fois, les mots choisis en titre prennent vie et deviennent programme. Chaque notion ou thème est présenté à l’aide de citations de la Bible, mais aussi d’auteurs chrétiens à travers l’Histoire, avec une large place faite aux anabaptistes du 16e siècle bien sûr. Au fil des pages, l’accent typiquement anabaptiste de la suivance du Christ sert de fil rouge.
Une des particularités de l’ouvrage est l’approche « en dialogue », au sens où les citations de provenances ecclésiales ou spirituelles diverses convergent de belle manière, comme un exemple de bienveillance mutuelle chère à l’auteur.
Le lecteur peut picorer ici ou là au gré des articles sans nécessité de tout lire à la suite ; des questions de réflexion et de discussion sont proposés à la fin de chaque article. « Le livre parcourt les grands thèmes de la foi pour mettre en valeur la singularité de l’approche anabaptiste. Un bel outil pour ceux qui veulent approfondir leurs racines spirituelles. » (Antoine Nouis)
Histoire, identité et dialogue
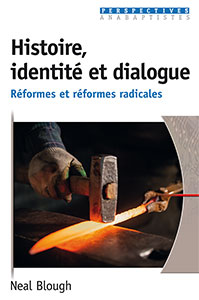 Réformes et réformes radicales
Réformes et réformes radicales
Auteur : Neal Blough
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 352
Poids : 440 grammes
Dépôt légal : Avril 2022
Dimensions : 14 x 21 x 1,9 centimètres
EAN / Référence : 9782755004793
Que celui qui est sans péché
 Entre minimisation et surenchère du péché
Entre minimisation et surenchère du péché
Sous la direction de : Michel Sommer – Denis Kennel
Auteurs : Denis Kennel – Michel Sommer – Lukas Amstutz – Janie Blough – Frédéric de Coninck – Hanspeter Jecker – Daniel Plessing – Marcus Weiand
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 168
Poids : 215 grammes
Dépôt légal : Mars 2019
Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres
EAN / Référence : 9782755003529
De l’Écriture à la communauté de disciples
 Sous la direction de : Neal Blough
Sous la direction de : Neal Blough
Auteurs : Frédéric de Coninck – Neal Blough – Michel Sommer – Paul Solomiac – Linda Oyer – Antonio González – Jean-Claude Girondin
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 328
Poids : 390 grammes
Dépôt légal : Mars 2016
Dimensions : 14 x 21 x 1,7 centimètres
EAN / Référence : 9782755002836
Dis-moi ce que tu crois…
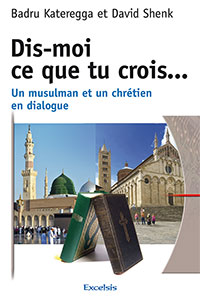 Un musulman et un chrétien en dialogue
Un musulman et un chrétien en dialogue
Titre original : A Muslim and a Christian in Dialogue
Auteurs : David Shenk – Badru Kateregga
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 312
Poids : 380 grammes
Dépôt légal : Juin 2015
Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755002386
De la paix du Christ à la « politique » de l’Église
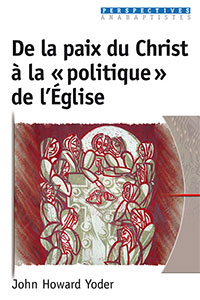 Titre original : He Came Preaching Peace
Titre original : He Came Preaching Peace
Auteur : John H. Yoder
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Vie d’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 272
Poids : 330 grammes
Dépôt légal : Novembre 2014
Dimensions : 14 x 21 x 1,4 centimètres
EAN / Référence : 9782755002195
Quand le pardon transcende la tragédie
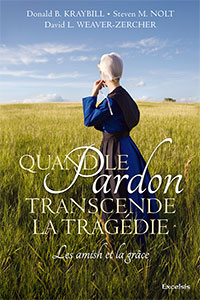 Les amish et la grâce
Les amish et la grâce
Titre original : Amish Grace
Auteurs : David Weaver-Zercher – Steven Nolt – Donald Kraybill
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Biographies / Témoignages
Déstockage
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 296
Poids : 370 grammes
Dépôt légal : Juin 2014
Dimensions : 14 x 21 x 1,5 centimètres
EAN / Référence : 9782755002119
Radicalement chrétien !
 Éléments essentiels de la démarche anabaptiste
Éléments essentiels de la démarche anabaptiste
Titre original : The Naked Anabaptist, The Bare Essentials of a Radical Faith
Auteur : Stuart Murray
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 200
Poids : 290 grammes
Dépôt légal : Septembre 2013
Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755001952
Catéchèse, baptême et mission
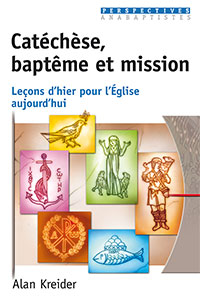 Auteur : Alan Kreider
Auteur : Alan Kreider
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Vie d’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 80
Poids : 120 grammes
Dépôt légal : Juin 2013
Dimensions : 14 x 20,9 x 0,5 centimètres
EAN / Référence : 9782755001839
Fascinant Saint-Esprit
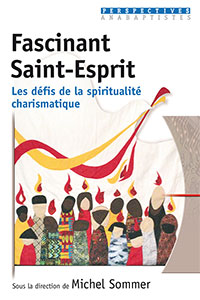 Les défis de la spiritualité charismatique
Les défis de la spiritualité charismatique
Sous la direction de : Michel Sommer
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Théologie » Doctrine du Saint-Esprit
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 160
Poids : 230 grammes
Dépôt légal : Octobre 2012
Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres
EAN / Référence : 9782755000627
Rythmes anabaptistes en Afrique
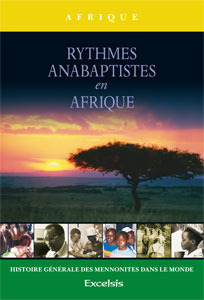 Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique
Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique
Titre original : Anabaptist Songs in African Hearts. A Global Mennonite History Series : Africa
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 312
Poids : 380 grammes
Dépôt légal : Mai 2012
Dimensions : 15 x 22 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755001617
Foi et tradition à l’épreuve
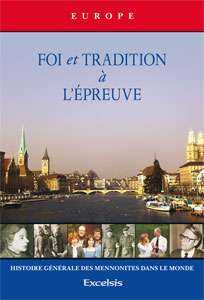 Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe
Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe
Titre original : Testing Faith and Tradition. A Global Mennonite History Series : Europe
Auteurs : Alle Hoekema – Neal Blough – Hanspeter Jecker
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 368
Poids : 440 grammes
Dépôt légal : Mai 2012
Dimensions : 15 x 22 x 1,9 centimètres
EAN / Référence : 9782755001624
Rédemption et salut
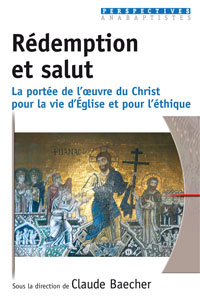 La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique
La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique
Sous la direction de : Claude Baecher
Auteurs : Pascal Keller – Frédéric de Coninck – Neal Blough – Claude Baecher – Linda Oyer – Rachel Reesor–Taylor
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Éthique
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 224
Poids : 290 grammes
Dépôt légal : Novembre 2011
Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755001402
Découvrir le réformateur Menno Simons
 Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons
Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons
Auteurs : Menno Simons – François Caudwell – Peter Riedemann
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 312
Poids : 390 grammes
Dépôt légal : Juin 2011
Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres
EAN / Référence : 9782755001334
Table des matières – Extrait 1
Histoire des amish
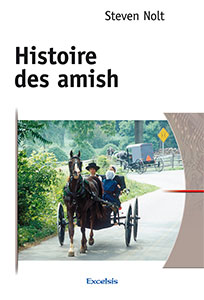 Titre original : A History of the Amish
Titre original : A History of the Amish
Auteur : Steven Nolt
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Biographies / Témoignages
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 352
Poids : 430 grammes
Dépôt légal : Novembre 2010
Dimensions : 15 x 22 x 1,7 centimètres
EAN / Référence : 9782755001181
Doctrine et vie des anabaptistes houttériens
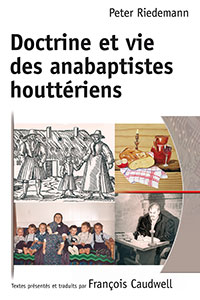 Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi
Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi
Auteurs : Peter Riedemann – François Caudwell
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 296
Poids : 335 grammes
Dépôt légal : Novembre 2007
Dimensions : 14 x 21 x 2,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755000573
La sagesse de la croix
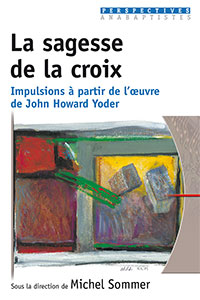 Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder
Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder
Sous la direction de : Michel Sommer
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 184
Poids : 232 grammes
Dépôt légal : Mai 2007
Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres
EAN / Référence : 9782755000528
Les Amish
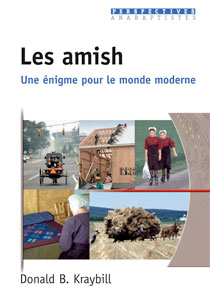 Une énigme pour le monde moderne
Une énigme pour le monde moderne
Titre original : The Riddle of Amish Culture
Auteur : Donald Kraybill
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Biographies / Témoignages
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 448
Poids : 540 grammes
Dépôt légal : Septembre 2004
Dimensions : 15 x 22 x 2,2 centimètres
EAN / Référence : 9782914144896
Miroir des martyrs
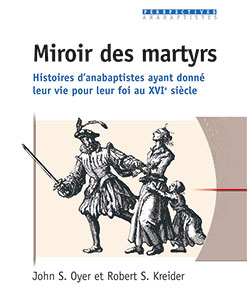 Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle
Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle
Titre original : Mirror of the Martyrs
Auteurs : Robert S. Kreider – John S. Oyer
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 96
Poids : 330 grammes
Dépôt légal : Mars 2003
Dimensions : 21,1 x 25,5 x 0,6 centimètres
EAN / Référence : 9782914144605
Michaël Sattler
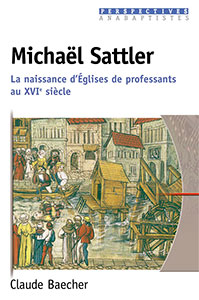 La naissance d’Églises de professants au 16e siècle
La naissance d’Églises de professants au 16e siècle
Auteur : Claude Baecher
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Histoire de l’Église
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 144
Poids : 210 grammes
Dépôt légal : Octobre 2002
Dimensions : 14 x 21 x 0,9 centimètres
EAN / Référence : 9782914144445
Table des matières
Eschatologie et vie quotidienne
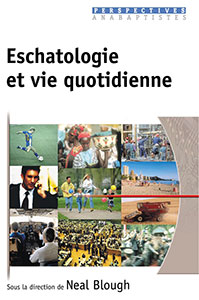 Sous la direction de : Neal Blough
Sous la direction de : Neal Blough
Auteurs : John H. Yoder – Linda Oyer – Bernard Huck – Frédéric de Coninck – Claude Baecher – Neal Blough
Éditeur : Excelsis
Collection : Perspectives anabaptistes
Catégorie 1 : Théologie » Doctrine des temps de la fin
Diffusion Excelsis
Pages (ou cartes) : 160
Poids : 190 grammes
Dépôt légal : Novembre 2001
Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres
EAN / Référence : 9782914144285
le Centre Mennonite de Paris est
une maison au service des Églises,
témoin du christianisme anabaptiste (paix, justice, réconciliation, accueil de l'autre)
dans un contexte multiculturel urbain,
ouvert au dialogue œcuménique et interreligieux.
Centre Mennonite de Paris
13, rue Val d'Osne
94410 SAINT-MAURICE
Tel : 01 43 96 12 32
centremennonite@orange.fr
Centre Mennonite de Paris
13, rue Val d'Osne
94410 SAINT-MAURICE
Tel : 01 43 96 12 32
centremennonite@orange.fr
le Centre Mennonite de Paris est
une maison au service des Églises,
témoin du christianisme anabaptiste (paix, justice, réconciliation, accueil de l'autre)
dans un contexte multiculturel urbain,
ouvert au dialogue œcuménique et interreligieux.
